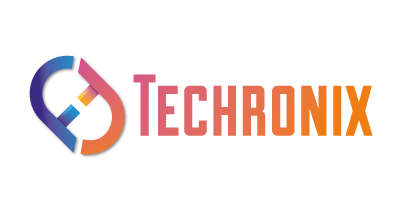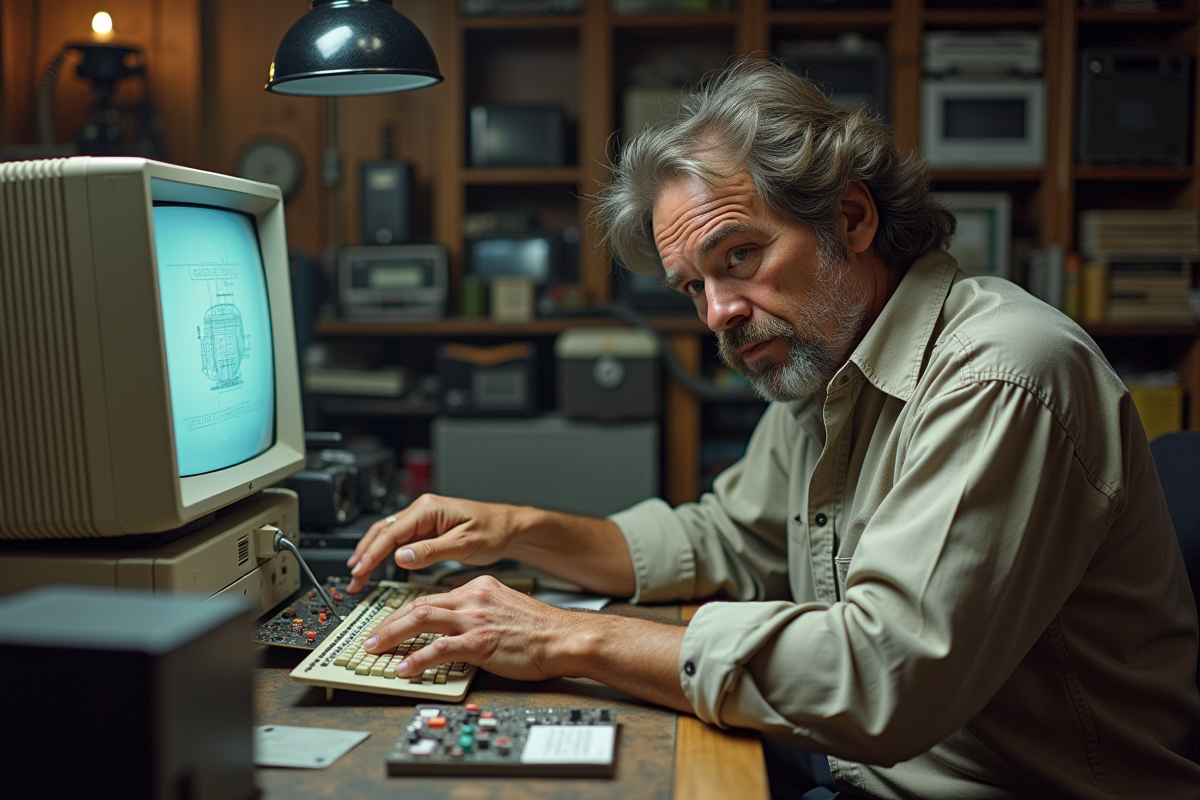Depuis le 1er janvier 2025, tout vol de drone équipé d’une caméra dans une zone résidentielle requiert une déclaration préalable auprès de la préfecture, même pour un usage non commercial. L’autorisation du propriétaire survolé ne suffit plus à garantir la légalité de l’opération.Les sanctions pour non-respect de ces dispositions incluent une amende pouvant atteindre 75 000 euros ainsi que la confiscation de l’appareil. Certaines exceptions subsistent toutefois pour des usages strictement récréatifs, à condition de respecter des altitudes et des horaires précis fixés par arrêté municipal.
Panorama 2025 : ce qui change dans la réglementation des drones de surveillance en France
L’année 2025 rebat sévèrement les cartes pour les utilisateurs de drones en France. Terminé le flou réglementaire : chaque drone, qu’il soit destiné à un loisir ou à la surveillance professionnelle, relève désormais de règles détaillées. L’administration française classe les modèles en sept catégories, de C0 à C6. À chaque classe ses contraintes en termes de poids, d’altitude maximale autorisée, et de dispositifs de sécurité obligatoires,rien n’a été laissé au hasard par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).
Côté professionnel, le cadre s’est resserré autour de deux scénarios européens qui remplacent les anciens dispositifs nationaux : STS-01 et STS-02. Le premier rend possible les survols à vue jusqu’à 120 mètres dans les zones peuplées. Le second encadre les vols hors vue, à condition de s’éloigner des villes et de renforcer considérablement les mesures de sécurité à bord.
Voici ce qui distingue ces deux scénarios pour toutes les entreprises et pilotes :
- STS-01 : autorise les opérations à vue en zone habitée, avec un plafond d’altitude limité à 120 mètres.
- STS-02 : permet les vols hors vue, uniquement hors zone urbaine et selon des critères de sécurité stricts.
L’harmonisation européenne met la pression aux opérateurs : chaque matériel doit être enregistré, le manuel d’exploitation (Manex) mis à jour, et l’exploitant doit pouvoir fournir à tout moment les justificatifs demandés lors d’un contrôle. Les alentours d’infrastructures sensibles ou de sites protégés restent strictement interdits à tout survol.
Quelles autorisations et démarches pour utiliser un drone à des fins de surveillance ?
Se servir d’un drone pour surveiller n’a plus rien d’improvisé. Il faut d’abord une inscription auprès des autorités compétentes, qui attribuent un numéro d’exploitant UAS unique pour chaque activité déclarée.
Ensuite, un dossier solide doit être monté : déclaration précise de l’activité, attestation d’assurance, description détaillée des procédures internes à travers le Manex, sans oublier la demande d’autorisation préfectorale si l’opération vise une zone sensible. Côté formation, les exigences sont montées d’un cran : un certificat ne suffit plus, il faut valider de nouveaux modules orientés vers la sécurité et la conformité européenne.
Dès lors qu’une caméra embarquée est de la partie, chaque vol implique des obligations supplémentaires : préserver la vie privée, s’assurer que le public est informé, identifier clairement l’exploitant, garder un registre à jour et vérifier la couverture de l’assurance.
Pour rester dans les clous, chaque étape doit être suivie avec méthode :
- Effectuer l’enregistrement administratif avant toute opération aérienne
- S’assurer que la formation des pilotes est à jour et les certificats valides
- Rédiger un Manex précis, adapté à la mission de surveillance programmée
- Appliquer des protocoles adaptés en fonction de la zone de vol
Ces démarches ne relèvent pas du détail, les contrôles sont fréquents et chaque document doit pouvoir être présenté sans délai.
Survol de propriétés privées : droits, limites et précautions à connaître
Utiliser un drone pour capter des images au-dessus d’un terrain privé s’accompagne forcément de précautions juridiques. Le code pénal et le RGPD fixent des lignes à ne pas franchir. Photographier ou filmer un bâtiment, même vide, oblige à respecter le droit à l’image de toute personne concernée. Omettre ce passage, c’est risquer de sérieux ennuis judiciaires.
La frontière entre espace public et privé n’est jamais anecdotique. Certaines zones restent totalement inaccessibles : établissements scolaires, hôpitaux, monuments historiques, tout ce qui relève du patrimoine protégé. Voler au-dessus d’une propriété sans autorisation écrite du propriétaire fait courir un risque réel de poursuites. Pour les images collectées, la loi « informatique et libertés » et le RGPD imposent un registre précis dès la première donnée visuelle enregistrée.
Dans ce contexte, il est indispensable de respecter les points suivants pour chaque opération de surveillance :
- Obtenir l’autorisation écrite du propriétaire avant toute intervention
- Informer précisément sur la présence du drone et le devenir des images
- Supprimer toutes les images dès qu’elles ne sont plus nécessaires
La CNIL recommande, en présence de données personnelles, d’effectuer systématiquement une analyse de risque spécifique. Les contrôles des forces de l’ordre se sont intensifiés, appuyés par le code de la sécurité intérieure. Tenter de contourner ces règles expose à des sanctions immédiates et sans appel.
Conseils pratiques pour rester en conformité lors de l’utilisation de drones de surveillance
Rien n’échappe plus à la vigilance des autorités lors du pilotage d’un drone dédié à la surveillance. Avant chaque vol, une vérification s’impose sur la conformité du matériel à la catégorie indiquée par la DGAC et sur la bonne marche des dispositifs exigés : signalement électronique, feux de position, tout doit fonctionner sans faille. Les marges d’erreur sont devenues quasi nulles lors des inspections terrain.
La préparation de chaque mission passe par une consultation rigoureuse des cartes officielles indiquant les zones interdites ou soumises à restrictions. La moindre entorse expose à une réaction immédiate, administrative comme pénale. Tenir à jour un registre précis des traitements d’images et de chaque vol s’est imposé, notamment en cas de contrôle RGPD ou d’audit sur la protection de la vie privée.
Pour voler serein et éviter les erreurs, certains réflexes doivent devenir des automatismes :
- Alerter les autorités locales en cas de survol près d’un site sensible
- Adopter la navigation à vitesse réduite quand la situation l’impose, pour garder la pleine maîtrise de l’appareil
- S’assurer que chaque pilote bénéficie d’une formation en cours de validité et connaît la conduite à tenir lors d’un incident technique ou d’un problème de sécurité
Le responsable du traitement des données prend à présent une place majeure : il surveille que les exigences relatives à la vie privée sont suivies à la lettre, qu’il s’agisse d’un projet interne ou d’une mission pour un client. Le moindre doute appelle la consultation des autorités compétentes. Même les opérateurs venus d’autres pays doivent jouer la transparence totale : procédure, justificatifs, rien n’est laissé au hasard. La nouvelle norme : l’exigence permanente, parce que la confiance dans les usages de la technologie n’attend plus.